D’après une étude intitulée « Phylogenetic studies of dogs with emphasis on Japanese and Asian breeds », menée par des chercheurs japonais et publiée en 2007 dans la revue Proceedings of the Japan Academy, les premiers chiens domestiques furent introduits au Japon à l'époque Jomon (une période historique allant de 13.000 à 400 ans avant J.-C.) par des personnes en provenance du sud ou du nord de l'Asie continentale. Plus précisément, les plus anciens restes trouvés dans le pays remontent à 9500 ans avant notre ère.
Après y avoir fait leur arrivée, les chiens se répandirent un peu partout dans l’archipel. Puis, au cours des périodes Yayoi (400 avant J.-C. à 250 après J.-C.) et Kofun (de 250 à 538 après J.-C.), d'autres chiens furent amenés en provenance de la péninsule coréenne, et se reproduisirent avec ceux qui étaient déjà présents sur place. Leurs descendants peuvent être considérés comme les ancêtres de la plupart des races japonaises qui existent encore aujourd'hui.

Selon une étude de marché publiée en 2021 par le GAIN (Global Agriculture Information Network) et le USDA (United States Department of Agriculture) consacrée au marché japonais des aliments pour animaux de compagnie, on comptait 8,5 millions de chiens domestiques dans l’archipel en 2020. Cela en fait le dixième pays du monde au classement (derrière les États-Unis, le Brésil, la Chine, l’Inde, la Russie, le Royaume-Uni, les Philippines, l’Allemagne et l’Argentine) et le quatrième en Asie.
L’estimation du nombre de chiens au Japon varie toutefois sensiblement d’une source à l’autre. En effet, des statistiques publiées en 2021 par la Japan Pet Food Association (JPFA) parlent plutôt de 7,1 millions d’individus cette année-là. Elles indiquent aussi qu’un peu moins de 10% des foyers japonais possédaient alors un chien, soit environ 5,7 millions de ménages. On constate d’ailleurs que posséder plusieurs chiens n’est pas rare, puisque cela fait une moyenne de 1,26 chiens par foyer concerné. Toutefois, c’est nettement moins courant que dans d’autres pays : par exemple, aux États-Unis, les foyers avec un chien en ont en moyenne 1,4. Au Canada, c’est même un peu plus de 1,5.
Toujours en 2021, les Nations Unies estimaient la population humaine japonaise à environ 126 millions de personnes : par conséquent, il y avait alors 67 chiens pour 1000 habitants. C’est faible comparé aux autres pays du top 10, et aux autres pays développés en général. Par exemple, le ratio est environ deux fois plus élevé en Allemagne et au Royaume-Uni, et même quatre fois plus aux États-Unis et au Brésil, les deux pays qui comptent le plus grand nombre de chiens de compagnie. En revanche, c’est environ deux fois plus que la Chine et cinq fois plus que l’Inde.
Il existe là aussi de légères différences de chiffres d’une source à l’autre, mais toutes aboutissent à un même constat : la tendance est à la baisse depuis la fin des années 2000. Ainsi, les statistiques d’Euromonitor International faisaient état en 2008 d’un pic de 13 millions de chiens, mais leur nombre n’était plus que de 11,5 millions en 2011. Celles de la Japan Pet Food Association montrent qu’il est ensuite passé sous les 10 millions en 2015.
Ainsi, le Japon est connu pour le déclin rapide de sa population humaine, mais sa population canine n’est pas en reste : elle a fondu de plus d’un tiers en moins d’une quinzaine d’années.
Il faut dire qu’en plus d’être de moins en moins nombreux, les Japonais sont de moins en moins enclins à avoir un chien. Ainsi, les statistiques publiées en 2021 par la Japan Pet Food Association (JPFA) montrent qu’un peu moins de 10% des foyers japonais (soit environ 5,6 millions de ménages) en possédaient alors un ; or, ce pourcentage était d’environ 13% en 2013 et 11% en 2017.
Ceci peut aussi s’expliquer notamment par le fait que de plus en plus de Japonais fuient les campagnes et petites villes en voie de désertification pour s’installer dans des très grandes agglomérations et vivre dans des appartements. Or, il est plus difficile d’avoir un chien en appartement, d’autant qu’au Japon les appartements tendent à être de petite taille. Surtout, il faut ajouter à cela qu’une large majorité des propriétaires interdisent de posséder un chien dans les logements qu’ils proposent - a fortiori quand il s’agit d’un appartement. Même si ce n’est pas le cas, dans ce pays où le savoir-vivre est de la plus haute importance, la crainte de causer une gêne pour les voisins peut être un frein – d’autant que les appartements sont souvent mal isolés.
Appréciés pour leur discrétion, leur autonomie, leur propreté et leur capacité à vivre cantonnés en intérieur, les chats sont logés à meilleure enseigne : leur nombre est relativement stable depuis le début du 21ème siècle, et se situe autour de 10 millions. Depuis le milieu des années 2010, le petit félin a donc pris l’ascendant sur le meilleur ami de l’Homme.

On dénombre 13 races japonaises : l’Akita Inu, l’Epagneul Japonais, le Hokkaïdo Ken, le Husky de Sakhaline, le Kai Ken, le Kishu Ken, le Ryūkyū Ken, le Sanshu, le Shiba Inu, le Shikoku Ken, le Spitz Japonais, le Terrier Japonais et le Tosa Inu.
La Fédération Cynologique Internationale (FCI) reconnaît une large majorité d’entre elles, puisque seules trois ne le sont pas (encore ?) : le Husky de Sakhaline, le Ryukyu Ken et le Sanshu. Cette large reconnaissance contribue grandement à la diffusion des chiens japonais un peu partout dans le monde, étant donné qu’une centaine d’organismes nationaux de référence sont membres de la FCI – c’est le cas notamment de ceux de la France (la Société Centrale Canine, ou SCC), de la Belgique (la Société Royale Saint-Hubert) et de la Suisse (la Société Cynologique Suisse, ou SCS).
Non membre de la FCI et très influent lui aussi, le Kennel Club (KC) britannique ne reconnaît quant à lui que quatre races japonaises : l’Akita Inu, l’Epagneul Japonais, le Spitz Japonais et le Shiba Inu.
En Amérique du Nord, l’American Kennel Club (AKC) reconnaît les dix mêmes races que la FCI : l’Akita Inu, l’Epagneul Japonais, le Hokkaïdo Ken, le Kai Ken, le Kishi Ken, le Shiba Inu, le Shikoku Ken, le Spitz Japonais, le Terrier Japonais et le Tosa Inu. En revanche, le Club Canin Canadien (CCC) se limite pour sa part à cinq : l’Akita Inu, l’Epagneul Japonais, le Shiba Inu, le Shikoku Ken et le Spitz Japonais.
Certaines races japonaises sont connues et appréciées à l’international, comme le Shiba Inu, l’Akita Inu et le Spitz Japonais. Bien qu’elles ne figurent pas dans les premières places des classements des races les plus appréciées à l’échelle internationale, elles suscitent pour certaines un réel engouement dans certains pays. Le Shiba Inu en particulier est de plus en plus présent un peu partout, notamment dans les grandes villes européennes. Certains influenceurs ont d’ailleurs contribué au phénomène en adoptant un chien de cette race et en le mettant en avant sur les réseaux sociaux – à l’image par exemple du français Squeezie avec Natsu, adopté au Japon.
Le Shiba Inu a également de nombreux adeptes dans son pays d’origine. Les chiffres d’enregistrements effectués entre 2018 et 2021 auprès du Japan Kennel Club (JKC) , l’organisme cynologique officiel du pays, montrent d’ailleurs qu’il était le seul chien autochtone à faire alors partie des 10 races les plus populaires.
En effet, ces dernières étaient (en ordre décroissant) le Caniche, le Teckel, le Chihuahua, le Spitz Allemand, le Shiba Inu (en 5ème position, donc), le Bouledogue Français, le Schnauzer Nain, le Yorkshire Terrier, le Shih Tzu et le Bichon Maltais.
Ainsi, on constate une forte prédilection des Japonais pour les races de petite taille, qui s’explique notamment par le taux d’urbanisation élevé et les logements généralement étroits. D'ailleurs, quand une race se décline en plusieurs variétés de tailles différentes, ce sont les plus petites qui sont les plus demandées. C’est flagrant par exemple avec le Caniche (plus de 95% des spécimens sont des Caniches Nains) et le Teckel (75% des sujets sont des Teckels Nains, et le reste sont des Kaninchen – le Teckel Standard représente moins de 1%). Plus largement, selon un rapport intitulé « The Pet Industry in Japan : Mini Report » et publié en 2017 par Export to Japan, deux-tiers des chiens du pays pesaient alors moins de 10 kg.
Chaque année, environ 300.000 chiens de race sont enregistrés auprès du Japan Kennel Club. Sachant que l’espérance de vie d’un chien au Japon approche les 15 ans et que la population canine du pays est de l’ordre de 8,5 millions d’individus, on peut donc estimer que près de la moitié des chiens du pays sont de pure race et dûment enregistrés comme tels. Même s’il est inférieur à celui observé par exemple en Allemagne, ce pourcentage est supérieur à celui de nombreux pays - même parmi les plus avancés.

Fondé en 1949 et basé à Tokyo, le Japan Kennel Club (JKC) est l’organisme cynologique de référence du Japon. Il a pour missions l’enregistrement des chiens de race et l’édition de leur pedigree, l’organisation d’expositions canines et de compétitions de sport canin, ainsi que la mise en place de formations et d’examens pour les éleveurs afin d’obtenir une qualification de « responsable d’élevage canin ».
Comme ses homologues d’environ 80 pays (dont ceux de la France, la Belgique et la Suisse), il est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI). Cela implique notamment que ses juges et les pedigrees qu’il émet sont reconnus par les autres organismes en question, et réciproquement au sein de ses organisations membres dans les autres pays.
Plus de 16 millions de chiens de race ont été enregistrés auprès du JKC de sa création en 1949 à 2020, et plus de 300.000 supplémentaires le sont chaque année. C’est donc le deuxième plus gros membre de la FCI en termes d’enregistrements annuels, non loin derrière la Russian Kynological Federation (RKF).

Il ressort de l'enquête nationale sur les chiens et les chats menée en 2021 par la Japan Pet Food Association (JPFA) que le taux de possession de chiens diminue d’année en année, en particulier chez les femmes célibataires et les femmes mariées sans enfants : alors qu’il était de 12,8% en 2013, il n’atteignait plus que 9,8% en 2021.
Les types de foyers possédant le plus souvent un chien sont les personnes mariées avec des enfants et les personnes sans conjoint avec des enfants. En effet, on trouvait un chien dans respectivement 13,7% et 13,6% d'entre eux. Ceux en possédant le moins sont les personnes vivant seules : seules 6% d’entre elles possédaient alors un chien.
La même étude montre que les propriétaires sont plus souvent des femmes que des hommes : 11,8% des premières possédaient alors un chien, contre 10,6% des seconds.
Par ailleurs, elle relève aussi que posséder un chien est plutôt l’apanage de personnes jeunes ou au contraire d’âge mûr sans être trop âgées. Ainsi, 12,6% des 20-29 ans, 12,2% des 50-59 ans et 11,7% des 60-69 ans possédaient un chien, contre seulement 9,2% des plus de 70 ans et 11% des 30-39 ans.
Enfin, un sondage effectué également par la Japan Pet Food Association (JPFA) montre que, quel que soit le canal choisi, la principale raison d’adopter un chien est le besoin de confort et de relaxation (30% des répondants), suivi par le décès d’un précédent animal de compagnie (27%) et l’envie d’améliorer la communication avec les membres de la famille (17%).

Le marché des produits et services pour animaux au Japon s’élevait à un peu plus de 1,7 trillion de yens en 2021 (environ 11 milliards d’euros), d’après les résultats d’une enquête menée par le Yano Research Institute. La nourriture représentait à elle seule environ 600 milliards de yens (environ 4 milliards d’euros), soit un peu plus d’un tiers du total.
Il existe de nombreux fabricants et distributeurs sur le marché. C’est le cas notamment en ce qui concerne l’alimentation, où les plus gros acteurs sont le japonais Unicharm ainsi que les américains Colgate-Palmolive (notamment avec la marque Hill’s) et Mars Japan (propriétaire notamment des marques Royal Canin et Pedigree). Les trois proposent une gamme étendue d'aliments dans tous les segments de prix, et représentent à eux seuls près de 30% des ventes. Unicharm est également bien positionné dans d’autres secteurs, à commencer par les produits d’hygiène pour animaux (par exemple les litières et les shampoings).
Par ailleurs, l'espérance de vie moyenne des chiens de compagnie au Japon est globalement élevée et augmente - comme on le constate d’ailleurs un peu partout. Ainsi, les chiffres de la Japan Pet Food Association (JPFA) montrent qu’elle était de 13,9 ans en 2010 et de 14,2 ans en 2013. Selon un rapport intitulé « The Pet Industry in Japan : Mini Report » et publié en 2017 par Export Japan, cela s’explique notamment par une alimentation et des soins de qualité, mais aussi par le fait que la plupart d'entre eux (plus de 70 %) vivent en intérieur. Ce document souligne également qu’à l’instar de la population humaine du pays, la population canine japonaise est assez âgée : la moitié des chiens et chats domestiques ont plus de 7 ans. Évidemment, cela n’est pas sans conséquence sur le marché des produits et services qui leur sont destinés, notamment en incitant les fabricants d’alimentation à proposer toutes sortes de produits conçus spécialement pour les animaux seniors.
En parallèle, certains accessoires pour chiens originaux ailleurs sont particulièrement populaires dans l’archipel. C’est le cas par exemple des poussettes destinées à les promener, très nombreuses dans les grandes métropoles japonaises. En effet, compte tenu notamment de l’importance de la propreté et de l’hygiène dans la culture nippone, de nombreux propriétaires préfèrent éviter que leur compagnon pose ses pattes à même le sol en extérieur (avec le risque ensuite de salir le logement) et font donc le choix de le déplacer dans une poussette. C’est aussi bien sûr un moyen de mieux contrôler ses déplacements et d’éviter tout accident. Permettant de donner à son animal un look « kawaii » (mignon), les vêtements pour chiens remportent eux aussi un grand succès au pays du Soleil-Levant.
Plus largement, le pays est connu pour son niveau de vie élevé, et les Japonais font rarement les choses à moitié : à partir du moment où ils décident d’avoir un chien, ils ne regardent pas à la dépense. Une enquête menée par la compagnie japonaise d'assurance pour animaux de compagnie Anicom Insurance a ainsi montré qu’en 2020, les propriétaires de chiens ont dépensé en moyenne près de 350.000 yens (environ 2600 euros) pour leur animal. Le premier poste de coûts est l’alimentation (à hauteur de 65.000 yens en moyenne, soit environ 500 euros), suivi de près par les frais vétérinaires (environ 60.000 yens par an, c’est-à-dire autour de 450 euros) puis les dépenses de toilettage (à hauteur de 50.000 yens par an, soit environ 400 euros).

Les statistiques du ministère de l’Environnement japonais montrent que parmi les chiens recueillis par les fourrières en 2020 et 2021, un peu plus de 10 % avaient été amenés directement par leur propriétaire pour être abandonnés – autrement dit, près de 9 sur 10 étaient des chiens abandonnés ou perdus dont le propriétaire n’avait alors pas encore été identifié.
Elles montrent aussi que le nombre de chiens pris en charge dans des fourrières chute de manière quasiment ininterrompue depuis au moins les années 70. Ainsi, alors qu’il approchait les 1,2 million en 1973, il n’était plus que d’environ 710.000 en 1989, 280.000 en 2000, 85.000 en 2010 et 28.000 en 2020.
Ceci s’explique notamment par le fait qu’un nombre croissant d'animaux sont pris en charge par des refuges et autres associations. L’une des organisations les plus actives en la matière est Animal Rescue Kansai qui, en dépit de son nom, est présente à la fois dans le Kansai (à Osaka) et dans le Kantō (à Tokyo).
Ces organismes tâchent de s’occuper des animaux jusqu’à leur trouver un nouveau foyer. Ce n’est pas le cas des fourrières, qui souvent décident de les euthanasier dès lors qu’ils n’ont pas été réclamés par leur propriétaire au bout d’un certain délai. Ce dernier est parfois est inférieur à une semaine, même si le fonctionnement exact diffère d’un établissement à l’autre.
La forte diminution du nombre de chiens admis en fourrière entraîne donc aussi une baisse du nombre de ceux qui y sont euthanasiés. Les chiffres du ministère de l’Environnement montrent qu’il est ainsi passé de 1,15 million en 1973 à 690.000 en 1989, 250.000 en 2000, 50.000 en 2010 et 4.000 en 2020. On constate d’ailleurs au passage que la proportion de chiens admis en fourrière qui finissent par y être euthanasiés s’est effondrée, elle aussi, passant en un demi-siècle de plus de 95% à moins de 15%. C’est surtout à partir des années 2000 que les choses ont changé radicalement à ce niveau, puisqu'à l’aube du troisième millénaire ce pourcentage frôlait encore les 90%.
La pratique de l’euthanasie est aussi en baisse grâce à une nouvelle loi sur le bien-être des animaux entrée en vigueur dans le pays en 2013. Auparavant, les organismes publics en charge de fourrières étaient obligés d’accepter tous les animaux, ce qui les conduisait à pratiquer de nombreuses euthanasies (y compris parfois d'individus ne présentant pas de problème majeur) pour pallier le manque de place et/ou simplement prévenir l’apparition de zoonoses (c'est-à-dire de maladies qu'un chien peut transmettre à l'Homme, à l'image par exemple de la rage). Depuis 2013, ces organismes peuvent décider de refuser un animal sous certaines conditions - par exemple s’il est malade ou âgé, ou bien si son propriétaire a déjà des antécédents d’abandons. En outre, cette législation vise à ce que les refuges fassent leur possible pour sensibiliser les propriétaires et futurs propriétaires d’animaux au bien-être animal et à l’intérêt de faire stériliser son chien, afin d’éviter les abandons en cas de portées non désirées ainsi que les euthanasies. Les refuges sont par ailleurs incités à mener des recherches dans le cas d’un animal perdu, afin de tâcher de retrouver son propriétaire.
Une autre mesure permettant de diminuer le nombre de chiens pris en charge par les fourrières et les associations est l’identification des animaux domestiques par mise en place d’une puce électronique. Toutefois, elle n’est obligatoire au Japon que depuis 2022 (à la fois pour les chiens et les chats), et de nombreux propriétaires ne sont pas conscients de cette obligation. En outre, comme l’a montré notamment une enquête d’opinions menée la même année par Japan Trend Research, beaucoup de maîtres sont réfractaires à l’idée de faire micropucer leur animal – avec des justifications parfois obscures... Pourtant, la micropuce permet d’associer le nom et l’adresse du maître à son chien, et donc de pouvoir l’identifier et le contacter en cas d’abandon (ce qui le responsabilise) ou bien sûr si son compagnon s’est perdu, par exemple du fait qu’il s’est échappé au cours d’une promenade ou à la suite d’une catastrophe naturelle.
Si la situation des fourrières et des refuges demeure très problématique au Japon, c’est en bonne partie parce que l’adoption d’animaux abandonnés n’y est pas chose courante : d’après une étude publiée en 2021 par la Japan Pet Food Association (JPFA), seuls un peu plus de 3% des propriétaires de chiens ont adopté leur compagnon auprès d’un refuge ou d’une association de protection animale, et moins de 2% l’ont trouvé dans la rue et recueilli.
Dans le même temps, comme l'archipel est globalement assez en retard sur les questions de bien-être animal par rapport aux autres pays développés, les animaleries y ont pignon sur rue. Il ressort ainsi de la même étude que plus de la moitié (51%) des maîtres ont adopté leur compagnon dans un tel commerce – souvent à prix d’or. 23% ont adopté directement auprès d’un éleveur, tandis que 13% ont obtenu leur animal via un ami ou une connaissance.
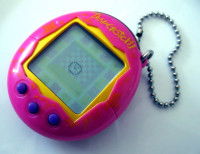

Hachiko était un Akita Inu adopté en 1923 par Hidesaburo Ueno (1872-1925), professeur à la prestigieuse université de Tokyo (Todaï). Son maître avait l’habitude de prendre le train à la gare de Shibuya pour se rendre au travail. Son chien l’y accompagnait chaque matin, et y retournait pour le retrouver en fin de journée.
Le 21 mai 1925, Ueno ne revint pas : il décéda brutalement d’un accident vasculaire-cérébral alors qu’il était en train d’enseigner. Néanmoins, jusqu’à sa mort près de 10 ans plus tard, en 1935, Hachiko resta fidèle à son maître, continuant à se rendre chaque fin de journée à la gare dans l’espoir de le retrouver.
Son histoire fut narrée dès 1932 par le célèbre quotidien Asahi Shimbun. Elle ne tarda pas à toucher les Japonais, tant elle reflétait des valeurs aujourd’hui encore primordiales à leurs yeux : la loyauté et le dévouement envers une figure d’autorité.
Le destin émouvant d’Hachiko sut également toucher les cœurs au-delà des mers, notamment grâce à deux films dont il est le héros. Paru en 1987, le premier est l’œuvre du réalisateur japonais Seijiro Koyama et s’intitule Hachikô Monogatari. Le second quant à lui est un film américain sorti en 2009 et nommé Hatchi, réalisé par le Suédois Lasse Hallström et avec Richard Gere comme acteur.
De nos jours encore, on trouve devant la gare de Shibuya une statue représentant Hachiko, qui fut créée en 1948. C’est un lieu de rendez-vous très prisé par de nombreux Tokyoïtes, et aussi une attraction pour les touristes du monde entier.