
Même si l’article 515-14 du Code civil français stipule qu’un animal relève du régime des biens plutôt que de celui des personnes, il va de soi qu’on n’acquière ou cède pas un chien comme on le ferait pour un quelconque produit de consommation.
Ainsi, une telle transaction (qu’elle soit effectuée à titre payante ou gratuite) nécessite le respect d’un certain formalisme contractuel, et différents documents doivent obligatoirement être remis par le cédant à l’acquéreur. L’objectif est non seulement d’offrir à ce dernier différentes garanties concernant l’animal dont il fait l’acquisition, mais aussi de faire reculer la maltraitance animale.
Cela dit, certains documents sont obligatoires dans l’ensemble des cas, tandis que d’autres ne le sont que dans certains.
Par ailleurs, il existe des documents que la loi n’impose pas au cédant de remettre lors de la cession d’un chien, mais qui sont fortement conseillés dans la mesure où ils protègent les deux parties et limitent les risques de mauvaise surprise.

En réglementant la cession d’un chien, que celle-ci soit effectuée à titre onéreux (vente) ou gratuit (don), la loi vise d’abord à protéger l'animal, mais aussi le cédant et l’adoptant. En effet, les documents exigés permettent de connaître sa provenance ainsi que ses origines, et ce quel que soit le statut du cédant : éleveur professionnel, refuge, association de protection des animaux sans refuge ou particulier. Cela permet de lutter contre les trafics d’animaux domestiques, donne à l’acquéreur de meilleures garanties quant à la santé physique et psychique de son compagnon à quatre pattes, et protège aussi le cédant, notamment contre d’éventuels recours.
Par ailleurs, cette législation s’inscrit également dans le cadre de la lutte contre l’abandon des chiens : en responsabilisant les deux parties, elle limite le risque d’adoption ou de cession irréfléchie.
Quand on s’interroge sur qui en France est autorisé à céder un chien, il convient de faire la distinction entre le cas d’un don et celui d’une vente.

La loi française autorise n’importe qui à céder gratuitement un chiot ou un chien adulte, qu’il soit de race ou pas : un éleveur, un particulier, une association de protection des animaux opérant ou non un refuge...
Dans le cas d’une association, il est courant qu’une contribution financière soit demandée. Pour autant, il ne s’agit pas d’un prix de vente : ce montant permet simplement de couvrir au moins en partie les sommes engagées pour en prendre soin (vaccins, nourriture, stérilisation s’il n’était pas encore stérilisé, identification s’il n’était pas encore identifié…), mais aussi de responsabiliser l’acquéreur en soulignant d’emblée qu’adopter un chien représente un engagement moral et financier.
La loi applicable à la vente d’un chien en France n’est pas la même selon qu’il s’agit d’un chiot ou d’un adulte.

À quelques exceptions près, la vente d’un chiot est réservée en France aux éleveurs professionnels.
En effet, l’Ordonnance n°2015-1243 du 7 octobre 2015 relative au commerce et à la protection des animaux de compagnie restreint énormément les conditions dans lesquelles un particulier peut vendre des chiots. Ainsi, il n’est autorisé à le faire que si ces derniers sont inscrits au Livre des Origines Français (LOF), ce qui suppose qu’ils soient de pure race, et s’il ne vend pas plus d’une portée par an. Au-delà, il est considéré comme éleveur, et doit donc avoir un statut de professionnel (c’est-à-dire notamment posséder un numéro de SIRET) – ce qui implique aussi qu’il est assujetti à la TVA.

Bien sûr, rien n’empêche un éleveur professionnel de céder à titre onéreux un chien adulte – par exemple un de ses reproducteurs qu’il met à la retraite.
En revanche, un particulier n’est autorisé à le faire que si cela est occasionnel et qu’il est en mesure de prouver que l’animal lui appartient.
Qu’il s’agisse d’une cession à titre payant (vente) ou à titre gratuit (don), et quels que soient le statut du cédant ainsi que celui de l’acquéreur, différents textes de loi imposent au premier de remettre au second un certain nombre de documents.

En vertu des articles L214-6 à L214-8-2 du Code rural et de la pêche maritime, modifiés par la Loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, un contrat de cession est obligatoire pour toute cession payante ou gratuite d’un chien, que ce dernier soit ou non de pure race et quel que soit le statut du cédant : éleveur professionnel, particulier, refuge ou association de protection des animaux n’opérant pas un refuge.
Aussi appelé parfois attestation de cession, certificat de cession ou contrat de vente, ce document doit être dûment daté et signé par les deux parties.
Tout cédant contrevenant à cette disposition s’expose à une amende de 135 à 750 euros, voire à la saisie de l’animal.
Bien qu'il représente une certaine contrainte, ce formalisme est très important pour les deux parties. D’une part, le document engage le cédant concernant les caractéristiques ainsi que la provenance et/ou les origines de l’animal, ce qui permet à l’acquéreur d’intenter un recours en cas de fausse déclaration (par exemple dans le cas d’une personne malhonnête qui tenterait de vendre un chien présenté comme étant de race alors qu’il ne l’est pas). D’autre part, en obligeant les deux parties à respecter l’ensemble des engagements pris et des dispositions convenues, il les protège aussi en rendant impossible toute modification réalisée de manière unilatérale - par exemple concernant le prix ou les modalités de livraison.
Il convient toutefois de souligner que dans le cas où le cédant et l’acquéreur sont tous deux des professionnels (par exemple, un éleveur canin qui vendrait un de ses chiens à un autre), une simple facture vaut contrat de cession, dès lors qu’elle comporte bien l’ensemble des informations que la loi impose sur ce dernier.
Celles-ci sont listées dans l’article 1 de l’Arrêté du 31 juillet 2022 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés au I de l’article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime.
La plupart concernent l’animal lui-même, mais d’autres sont relatives aux co-contractants ainsi qu’aux modalités de la transaction.
Bien sûr, rien n’empêche d’y ajouter aussi toutes sortes d’autres informations ou dispositions.

Fort logiquement, le contrat de cession doit comporter certaines informations relatives aux parties au contrat – c’est-à-dire au cédant et à l’acquéreur :

C’est évidemment sur l’animal qui est cédé que le contrat de cession doit fournir le plus de détails. Doivent en effet y être indiqués :
Dans le cas d’un chien de race, plusieurs mentions supplémentaires sont obligatoires :

Si la cession concerne un chien de race, le contrat de cession doit également rappeler la liste des maladies considérées par la loi française comme des vices rédhibitoires – ou plus précisément des vices cachés, au sens des articles 1641 à 1649 du Code civil.
Il s’agit :
ll doit également rappeler les voies de recours légales, c’est-à-dire la possibilité pour l’acquéreur d’engager des poursuites contre le cédant si suite à la cession il s’aperçoit dans un laps de temps défini par la loi que l’animal est atteint par l’une d’entre elles.

En plus d’informations sur les parties ainsi que sur la chose cédée, le contrat de cession doit obligatoirement préciser :
Depuis le début des années 2010, les chiens dont le propriétaire réside en France doivent être identifiés et avoir une carte à leur nom qui prouve que c’est bien le cas.

En vertu d’un Arrêté ministériel de 2012 relatif à l'identification des carnivores domestiques et fixant les modalités de mise en œuvre du fichier national d'identification des carnivores domestiques, qui modifie l’article L212-10 du Code rural et de la pêche maritime, tout chien (de race ou pas) dont le propriétaire vit en France doit entre l’âge de deux et quatre mois être identifié par puce électronique ou par tatouage, sous peine d’une amende de 750 euros.
Cette identification conduit à son inscription dans le Fichier National d’Identification des Carnivores Domestiques (I-CAD) géré par la société Ingenium Animalis, qui agit sous délégation du ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire.
Elle doit être réalisée par un vétérinaire (ou un tatoueur agréé dans le cas du tatouage, mais cette technique est de moins en moins employée).
Une fois la puce posée ou le tatouage effectué, le vétérinaire ou le tatoueur délivre un certificat provisoire d’identification, valable un mois. Jusqu’en 2024, le propriétaire recevait quelques jours plus tard par voie postale la carte définitive émise par l’I-CAD : désormais, il doit se rendre lui-même sur le site de ce dernier afin de la télécharger au format PDF et/ou l’imprimer.
Si par la suite l’animal change de propriétaire, il est obligatoire de mettre alors à jour sa carte d’identification. Pour cela, le cédant doit en amont ou lors de la cession indiquer dans un formulaire prévu à cet effet sur le site de l’I-CAD l’adresse e-mail ou le numéro de téléphone mobile de l’acquéreur. Cela permet de faire en sorte que le transfert soit répercuté dans la base de données et que le nouveau propriétaire puisse obtenir la carte d’identification mise à jour, après s’être créé lui aussi un espace détenteur s’il n’en a pas déjà un.

L’identification est utile aussi pour voyager à l’étranger avec son chien.
C’est le cas en particulier depuis 2011 pour se rendre avec lui dans un autre pays de l’Union européenne – en plus du passeport européen pour animaux de compagnie. Il convient d’ailleurs de souligner que dans ce cadre, seule la puce est acceptée pour les animaux identifiés après juillet 2011 – ce qui contribue aussi à expliquer pourquoi le tatouage est de moins en moins répandu.
En dehors de l’UE, de nombreux autres pays exigent eux aussi une preuve de cette identification afin d’être autorisé à y faire entrer son chien.

La carte d’identification d’un chien comporte les informations suivantes :

Au-delà du fait qu’elle réduit les vols de chiens (une déclaration de vol enregistrée dans l’I-CAD alerte tous les professionnels qui utilisent le fichier et empêche toute cession de l’animal concerné), l’identification offre des garanties aux deux parties lors d’une cession.
En ce qui concerne le cédant, elle atteste de la traçabilité de l’animal et prouve que ce dernier ne provient pas d’un trafic et n’a pas été volé.
Du point de vue de l’acquéreur, elle permet non seulement de connaître la provenance de son nouveau compagnon, mais également d’en devenir officiellement le nouveau propriétaire lors du transfert.
Par ailleurs, que ce soit dans le cas d’un chien que l’on possède depuis sa naissance ou que l’on a acquis au cours de son existence, l’identification augmente fortement les chances de le récupérer en cas de perte de ou de vol. En effet, tout professionnel (vétérinaire, refuge, mairie, fourrière…) équipé du lecteur idoine est alors en mesure de connaître son numéro d’identification, et ce faisant les coordonnées de son propriétaire. Selon le ministère de l’Agriculture et de la Souveraineté alimentaire, un chien perdu a 90 % de chances d’être retrouvé s’il est identifié, contre seulement 15 % s‘il ne l’est pas.
Il faut savoir aussi que tout animal trouvé sur la voie publique est considéré en divagation, et peut donc se retrouver en fourrière. Or, s’il n’est pas identifié, cela signifie qu’a priori il n’a pas de propriétaire, et donc il risque alors d’être stérilisé – voire euthanasié.

En vertu de l’Article D214-32-2 du Code rural et de la pêche maritime, modifié par le Décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale, toute personne ou organisation cédant un chien à titre onéreux (vente) ou gratuit (don) doit fournir un certificat vétérinaire – aussi appelé certificat de bonne santé – datant de moins de trois mois, et ce quel que soit son statut : particulier, éleveur professionnel, refuge ou association de protection des animaux n’opérant pas un refuge. À défaut, elle est passible d’une amende de 135 à 750 euros, voire de la saisie de l’animal par les autorités.
Ce document doit être émis par un vétérinaire que le cédant a toute latitude pour choisir. Il est établi au terme d’un examen clinique ayant pour but de déterminer l’état de santé apparent de l’animal, et qui porte sur une dizaine de points de contrôle :
Le praticien doit noter sur le certificat toute anomalie ou pathologie qu’il aurait constatée au cours de l’examen clinique, et y préciser s’il demande des examens complémentaires.
Dans un tout autre registre, il doit également écrire si l’animal est catégorisé au titre de la loi française sur les chiens dangereux. Par ailleurs, si ce dernier a déjà fait l’objet d’une voire plusieurs évaluation(s) comportementale(e), le vétérinaire doit reporter sur le certificat la date ainsi que le résultat de la dernière d’entre elles.
Le document doit également indiquer :
Concernant ce dernier point, si la cession concerne un chiot inscrit au Livre des Origines Français (LOF), une copie de la déclaration de portée doit être jointe au certificat vétérinaire afin de servir de preuve de cette inscription.

Le certificat d’engagement et de connaissance (CEC) est instauré par la Loi n°2021-1539 du 30 novembre 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et conforter le lien entre les animaux et les hommes, qui modifie l'article L214-8 V du Code rural et de la pêche maritime ainsi que l'article D214-32-4 du Code rural et de la pêche maritime. Les modalités exactes de sa mise en œuvre sont finalisées par le Décret n°2022-1012 du 18 juillet 2022 relatif à la protection des animaux de compagnie et des équidés contre la maltraitance animale.
Ainsi, la loi française impose que l’acquéreur d’un chien, d’un chat, d’un furet, d’un lapin de compagnie ou d’un équidé signe en amont de la transaction ce document et le remette au cédant. Si ce dernier n’est pas en mesure de présenter ce document signé, il est passible d’une amende de 68 euros.
L’objectif du certificat d’engagement et de connaissance est de sensibiliser et responsabiliser l’acquéreur avant la cession, afin de lutter contre les adoptions irréfléchies et réduire les risques de maltraitance (y compris involontaire par manque de connaissance) ainsi que les abandons.
Ainsi, il doit préciser au moins :
En règle générale, un éleveur professionnel ou une association (qu’elle opère ou non un refuge) dispose déjà d’un document prêt à l’emploi. Dans tous les cas, l’une ou l’autre des parties peut facilement s’en procurer un auprès d’un vétérinaire ou en ligne : on trouve de nombreux modèles de CEC disponibles gratuitement sur Internet.
En signant le certificat d’engagement et de connaissance, l’acquéreur atteste avoir pris connaissance des besoins de l’animal qu’il s’apprête à acquérir, et s’engage à les respecter.
Il doit remettre le document signé au cédant au moins sept jours avant la date de la signature du contrat de cession, que celle-ci se fasse à titre onéreux (vente) ou à titre gratuit (don).
Enfin, il faut savoir que ce document porte sur une seule espèce, mais n’a pas de date de fin de validité (contrairement par exemple au certificat vétérinaire). Autrement dit, si par la suite on acquiert à nouveau un animal de la même espèce, il n’est pas nécessaire de signer un nouveau CEC : on peut fournir simplement le précédent, si on en avait conservé au moins un exemplaire.
Certains documents sont obligatoires lors de l’acquisition et la cession d’un chien quel que soit le cas de figure – et notamment le statut du cédant ainsi que les caractéristiques du chien (en particulier le fait qu’il soit de race ou non, et la race à laquelle il appartient le cas échéant).
D’autres en revanche ne le sont que dans certaines configurations : il s’agit du certificat de naissance ou du pedigree, du carnet de santé, du passeport européen ainsi que du livret d’accueil.

Un certificat de naissance et un pedigree sont des documents officiels qui concernent exclusivement les chiens de race. En France, ils sont émis par la Société Centrale Canine (SCC), qui est l’organisme de référence désigné par les autorités françaises pour tout ce qui a trait aux chiens de race dans le pays. En particulier, il en gère le registre complet : le Livre des Origines Français (LOF).
Le pedigree fait état des origines et de la généalogie d’un chien inscrit au LOF : c’est le document qui permet de prouver que ce dernier est effectivement de pure race. Il n’y a pas qu’en France qu’il est reconnu : en effet, la SCC est membre de la Fédération Cynologique Internationale (FCI), au même titre que ses homologues d’une centaine de pays. Or, cette dernière impose notamment à ses membres la reconnaissance mutuelle de leurs pedigrees.
Le pedigree est délivré une fois que le chien a passé et réussi un examen de confirmation, qui permet de s’assurer qu’il est conforme au standard de la race. Toutefois, il ne peut le faire qu’après avoir atteint son âge adulte : selon les races, le seuil est fixé entre 12 et 18 mois.
Il s’agit là en réalité la dernière étape d’un processus qui en compte plusieurs. La première est la déclaration de portée auprès de la SCC, qui doit être effectuée dans les huit jours suivant la naissance. Une fois le chiot identifié par puce électronique ou tatouage (ce qui doit être fait entre ses deux mois et ses quatre mois), on peut demander son inscription au LOF à titre provisoire (l’inscription définitive survient après la réussite de l’examen de confirmation) : cette démarche permet d’obtenir de la part de l’organisme un certificat de naissance (ou pedigree provisoire) prouvant qu’il est inscrit au LOF.
Bien que leur couleur diffère (le certificat de naissance est bleu, alors que le pedigree est ocre), les deux documents se ressemblent beaucoup. Ils mentionnent :
Il est possible d’y ajouter par la suite d’autres informations sous forme d’abréviations, notamment concernant :

Lors de la cession d’un chien de pure race, l’article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime oblige le cédant à fournir à l’acquéreur le pedigree - ou à défaut le certificat de naissance –, car cela permet de prouver que l'animal est bien inscrit au LOF. Il peut en outre s’occuper de demander à la SCC de mettre à jour le nom du propriétaire avant la cession, ou bien laisser l’acquéreur s’en charger après.
La remise de ce document est obligatoire pour tout chien de race, quel que soit le statut du cédant (particulier, éleveur professionnel ou association) et que la cession soit effectuée à titre payant ou gratuit.
En effet, il est important pour les deux parties, car il offre des garanties quant à la provenance et la lignée de l’animal. Cela donne au cédant une légitimité pour justifier un prix plus ou moins élevé (dans le cas d’une vente), et à l’acquéreur l’assurance que le montant en question est justifié notamment par le fait que son futur compagnon est bien de pure race.
Lorsque la transaction concerne un chiot, il est possible qu’au moment de la cession le cédant n’ait pas encore obtenu le certificat de naissance, car les délais de traitement par la SCC sont parfois longs. Dans ce cas, il doit s’engager – de préférence par écrit – à l’envoyer à l’acquéreur dès réception, et à ses frais.

En vertu de l’Arrêté ministériel du 31 juillet 2012 relatif aux mentions essentielles devant figurer sur les équipements utilisés pour la présentation des animaux de compagnie d’espèces domestiques en vue de leur cession ainsi qu’au contenu du document d’information et de l’attestation de cession mentionnés dans l’article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime, un éleveur professionnel a l’obligation de remettre à toute personne à qui il cède un chien un livret d’accueil, parfois appelé aussi livret d’accompagnement ou notice d’élevage. À défaut, il est passible d’une amende de 68 euros.
Un particulier ou une association (par exemple opérant un refuge) qui cède un chien n’est en revanche pas tenu par cette obligation, que la cession soit à titre onéreux ou gratuite.
Le livret d’accueil doit fournir à la fois des informations sur l’espèce et la race de l’animal, mais également différents conseils pour s’en occuper au mieux.

L’arrêté ministériel de 2012 stipule que le livret d’accueil doit fournir au moins les informations suivantes concernant l’animal :
En plus de ces informations, le livret d’accueil doit fournir à l’acquéreur différents conseils pour qu’il puisse s’occuper au mieux de son futur compagnon. Dans le cas d’un chien, il doit donc aborder au minima les sujets suivants :
En parallèle des types de documents que la loi française impose systématiquement ou dans certains cas lors de la cession et l’acquisition d’un chien, il convient d’en évoquer deux autres qui ont aussi un intérêt et servent les deux parties, dans le sens où ils offrent des garanties supplémentaires : d’une part, les résultats des éventuels tests de dépistage effectués sur les parents, et d’autre part le contrat de réservation dans le cas où la cession n’est pas immédiate.
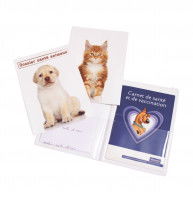
Comme son nom l'indique, le carnet de santé d’un chien contient des informations relatives à sa santé. On y trouve ainsi :
Il contient également de nombreuses informations sur l’accueil d’un chien, son entretien, son alimentation, son éducation, sa reproduction, les vermifuges…
Historiquement, le carnet de santé est au format papier. Il est généralement créé par le vétérinaire lors de la première visite du chiot (ou au plus tard lors de sa primo-vaccination), et doit être présenté lors de chaque consultation ultérieure, afin que tout praticien amené à prendre en charge l’animal dispose des meilleures informations possibles et complète ces dernières - ce durant toute la vie de l’intéressé.
Toutefois, il existe désormais de nombreuses applications gratuites ou payantes qui en proposent une version dématérialisée et sécurisée fonctionnant exactement sur le même principe, c’est-à-dire consultable et à compléter par tout praticien amené à prendre en charge l’animal. Il faut cependant savoir que si on opte pour un carnet de santé numérique, il est obligatoire qu’un vétérinaire certifie les informations qu’il contient.
Contrairement à ce qu’on pourrait penser, le cédant n’a pas l’obligation légale de fournir systématiquement un carnet de santé, puisqu’un chien n’en a pas forcément un.
En effet, faire vacciner son chien contre les maladies canines courantes (maladie de Carré, hépatite de Rubarth, parvovirose, leptospirose et toux du chenil) est fortement recommandé, mais ce n’est pas obligatoire en France. Or, le carnet de santé sert – entre autres – à prouver que l’animal est vacciné contre ces maladies. Par conséquent, un animal cédé non vacciné et n’ayant jamais consulté un vétérinaire pour un problème de santé n’a aucune raison d’avoir un carnet de santé établi à son nom.
En ce qui concerne la rage, la vaccination des chiens était autrefois obligatoire dans certains départements français. Toutefois, ce n’est plus le cas de nos jours, car la rage a officiellement disparu du territoire en tant que maladie endémique. Il y a toutefois une exception : la Loi du 20 juin 2008 renforçant les mesures de prévention et de protection des personnes contre les chiens dangereux impose aux propriétaires de chiens de catégorie 2 (telle que définie par la loi française sur les chiens dangereux) de faire vacciner leur animal contre cette maladie afin d’obtenir le permis de détention nécessaire pour avoir un tel chien. Cependant, il faut savoir que la pièce à fournir en cas de contrôle concernant la vaccination antirabique (en particulier lors d’un voyage à l’étranger) n’est pas le carnet de santé mais le passeport européen pour animaux de compagnie, où figurent les vignettes du vaccin qui a été administré.
Cela dit, le fait qu’un chien n’ait pas de carnet de santé (notamment si on choisit de ne pas le faire vacciner contre les maladies courantes) a tôt fait d’être bloquant si on souhaite voyager à l’étranger avec lui. En effet, ce document est obligatoire pour qu’il soit autorisé à entrer dans n’importe quel État de l’Union Européenne, mais aussi dans de nombreux autres pays qui ne font pas partie de cette dernière - en plus du passeport où est consigné sa vaccination contre la rage.
Cela a aussi de grandes chances d’être problématique tout simplement pour le confier à une pension canine. En effet, la plupart des responsables de tels établissements exigent une preuve que l’animal qu’on souhaite leur confier est bien vacciné contre certaines maladies canines courantes et dangereuses.
Il en va souvent de même dans les lieux d'hébergement collectifs - par exemple les campings.
Ainsi, même si pour le coup il n’y a aucune obligation légale en ce sens, un éleveur sérieux (professionnel ou pas) fait en sorte que tout chien qu’il propose à la vente soit vacciné contre la maladie de Carré, l’hépatite de Rubarth, la parvovirose, la leptospirose ainsi que la toux du chenil et possède donc un carnet de santé, dans lequel ces vaccins sont consignés et qu’il prend soin de remettre à l’acquéreur.
Plus largement, toute personne cédant un chien a intérêt à faire vacciner ce dernier. C’est particulièrement vrai dans le cas de la vente d’un chien de race, étant donné que cela permet de le mettre à l’abri de certaines maladies considérées comme des vices rédhibitoires. En effet, s’il venait à développer l’une d’entre elles dans un certain délai suivant la cession, l’acheteur pourrait engager un recours en justice afin de faire annuler cette dernière.
Au-delà de ces considérations, il faut avoir conscience que le carnet de santé est bien plus qu’un simple carnet de vaccination : il contient normalement tous les antécédents médicaux de l’animal (maladies, accidents, soins et/ou traitements reçus tout au long de sa vie…). C’est particulièrement utile lorsqu’un vétérinaire qui ne le connaît pas encore doit le prendre en charge.
De fait, qu’il s’agisse d’un professionnel ou d’un particulier, un cédant qui affirme que le chien ne possède pas de carnet de santé ou refuse de remettre ce dernier a potentiellement quelque chose à cacher. En tout état de cause, cela voudrait dire qu’on se retrouve avec un chien dont on ne sait rien sur sa santé : ce peut être assez problématique, en particulier s’il a déjà quelques années voire est âgé. Ainsi, dans un tel cas de figure, mieux vaut passer son chemin et s’adresser à quelqu’un d’autre.

Via l’article L214-8 du Code rural et de la pêche maritime, la loi française interdit de vendre ou de donner un chiot âgé de moins de huit semaines. En revanche, rien n’empêche d’appliquer l’article 1130 du Code civil (qui stipule que « les choses futures peuvent être l’objet d’une obligation ») à la cession et l’acquisition d’un animal : autrement dit, il est possible en revanche de proposer à la réservation un chiot qui n’a pas encore atteint l’âge légal pour être cédé, voire même qui n’est pas encore né. Dans le cas d’éleveurs très réputés ou de races peu répandues, une telle réservation est d’ailleurs parfois indispensable pour parvenir à acquérir l’animal que l’on souhaite.
En tout état de cause, cette possibilité existe quel que soit le statut du cédant (éleveur professionnel, particulier ou association), et que le chien soit de race ou non.
Même si la loi ne l’impose pas, il est alors fortement conseillé de conclure un contrat de réservation (parfois désigné « fiche de réservation ») signé par les deux parties.
En effet, qu’on parle d’un chiot n’ayant pas encore l’âge de huit semaines ou d’un chiot à naître, tant le cédant que l’acquéreur ont tout intérêt à ne pas se contenter d’un accord verbal, au risque d’une mauvaise surprise au moment de la cession. Par exemple, il pourrait arriver alors que le propriétaire ait en fait déjà cédé l’animal ou simplement décidé de le garder, mais aussi que l’acquéreur ait entretemps jeté son dévolu sur un autre chien ou tout simplement changé d’avis.
Le contrat de réservation est un document qui engage les deux parties à respecter les obligations et dispositions qu’elles décident d’y faire figurer. Dans la mesure où contrairement au contrat de cession il n’est ni imposé ni encadré par la loi, celles-ci disposent d’une grande liberté en la matière – même si bien sûr elles doivent respecter les dispositions qui sont d’ordre public, comme pour n’importe quel contrat.
Normalement, dès lors qu’une réservation est effectivement nécessaire, un éleveur professionnel sérieux propose de lui-même d’établir un contrat et dispose déjà d’un document prêt à l’emploi. Dans le cas contraire, la méfiance s’impose.
De nombreux modèles sont disponibles sur Internet, mais voici les informations qu’on y trouve généralement au minimum :
Que ce soit de son propre chef ou à la demande de l’acquéreur, le cédant peut également y faire figurer toutes sortes d’autres informations jugées utiles, comme :
La cession d’un chiot en elle-même est encadrée par la loi, mais ce n’est pas le cas de sa réservation. Il est donc important de bien expliciter dans le contrat de réservation l’ensemble des points auxquels le cédant ou l’acquéreur accordent de l’importance, afin d’éviter toute mauvaise surprise.
En particulier, il faut savoir que si la réservation se fait chez le cédant ou dans le cadre d’un salon ou d’une foire, l’acquéreur ne dispose pas d’un délai légal de rétractation : ce dernier n’existe que dans le cas d’une vente à distance, conformément à l’article L221-18 du Code de la consommation. Les deux parties peuvent se mettre d’accord pour en définir un, mais cela doit alors être clairement stipulé dans le contrat.
Par ailleurs, dans le cas d’une vente, le cédant exige généralement le versement par l’acquéreur d’une avance sous forme d’acompte ou d’arrhes. Or, ce n’est pas du tout la même chose.
En effet, sauf dispositions particulières définies par les deux parties et mentionnées explicitement dans le contrat, l’acompte engage le cédant à céder et l’acquéreur à acquérir. Par conséquent, le premier doit rembourser cette somme si au final il décide de ne pas vendre le chiot (ou n’est pas en mesure de le faire), tandis que le second est obligé de s’acquitter du prix total à la date prévue pour la cession, même s’il renonce à adopter le petit.
En revanche, toujours sauf dispositions particulières convenues dans le contrat, les arrhes n’engagent pas les parties à finaliser la vente. Ainsi, l’acquéreur demeure libre de renoncer à l’achat du chiot : il perd alors les arrhes versés, mais ne doit rien de plus. Si c’est le cédant qui finalement renonce à la transaction, il doit rembourser le double des arrhes payés par le cessionnaire.
Il convient d’ailleurs de souligner que si rien n’est stipulé à ce sujet, une somme que l’on doit verser à l’avance sont des arrhes et non un acompte.

Les maladies héréditaires des chiens se comptent par centaines, et comme il s’agit de l’espèce la plus étudiée après l’Homme du point de vue médical, on en découvre régulièrement de nouvelles.
Il existe de plus en plus de tests et d’examens de dépistage qu’il est possible d’effectuer sur les reproducteurs potentiels ou sur les chiots pour lutter contre la transmission de ces pathologies. On peut ainsi recourir à :
Certains de ces tests et examens ne sont réalisables que par un vétérinaire : c’est le cas par exemple des échographies et des radiographies. En revanche, les tests génétiques peuvent être effectués simplement par un éleveur professionnel ou un particulier.
Toutefois, ils représentent un certain coût : dans la pratique, ce sont donc essentiellement les éleveurs qui y ont recours, et donc surtout les chiens de race qui sont ainsi testés – ce qui contribue d’ailleurs à justifier leur prix.
En tout cas, quand on cède ou acquiert un chien (a fortiori s’il est de race), on a tout intérêt à ce que ses parents ou lui-même aient fait l’objet de tels tests, et à transmettre / obtenir les résultats en amont de la transaction – ou même de la réservation de l’animal le cas échéant :
Il convient d’ailleurs de souligner qu’un nombre croissant de clubs de race dressent une liste de tests qu’ils imposent d’effectuer aux éleveurs qui en sont membres, afin d’améliorer sans cesse la santé de la population de la race en question.
Plus généralement, l’existence et le recours de plus en plus fréquent à ces tests n’est pas étranger à l’augmentation substantielle de la durée de vie des chiens qu’on observe depuis plusieurs décennies.
À l’image ce qu’on observe dans d’autres pays, la législation française accorde une place de plus en plus importante aux chiens et aux autres animaux de compagnie. Cela passe notamment par le fait d’imposer toutes sortes de documents lors d’une cession (qu’elle soit payante ou gratuite), notamment afin de lutter contre les trafics et les maltraitances.
Règlementer davantage la cession d’un chien permet également d’offrir de meilleures garanties aux deux parties, en particulier sur les origines de l’animal concerné (a fortiori s’il est de pure race) ainsi que sa santé.
Pour autant, cela ne fait pas disparaître les personnes mal intentionnées. Il demeure donc utile de faire preuve de vigilance et de savoir comment éviter les arnaques lors de l’achat d’un chien.






particulier ou éleveur , la loi doit etre pareil pour les 2.le chiot inapte à sa destination devrait etre repris ou rembourser au moins par moitié et si le contrat de vente était obligatoier pour tout vendeur il y aurai bien moins de problèmes entre les 2 parties.j'ai acheter un chiot lof de 5 mois,chez un particulier. conditions qu'il chasse et qu'il soit confirmable car projet de faire une porté pour garder un chiot.le vendeur pour lui tout est ok , il me fournis meme les coordonnées d'un juge pour confirmer ma chienne.mais me précise de ne pas prendre peur car il est gynécologue.le certificat de santé n'est plus valable car valable que 5 jours et qu'il a été fait à 2 mois .voila ma chienne qui a 1 an et une exposition est prévu à 15 mn de chez moi, alors pas d'hésitation je l'inscris.le jour de la confirmation le juge la met non confirmable pour prognatisme, apres plusieur renseignement auprés d'éleveur je peux vous dire de ne jamais amener votre chien en expo mais directement chez un juge car beaucoup d'arnaque, alors pourquoi acheter du lof???? autant avoir un type le résultat est le meme mais pas au meme prix. voila pourquoi je maintient que les documents doivent etre obligatoire autant pour les particuliers que les éleveurs.
@ cacheleux : Aucune loi n'oblige un vendeur à reprendre le chien vendu et qui plus est à rembourser l'acheteur. A moins que cela ne soit précisé noir sur blanc, sur l'attestation de vente initiale.
@ martin : Le minimum pour un acheteur ou ou adoptant est de se renseigner "avant" d'acquérir un animal. Internet regorge d'informations. Quand une personne va acheter un canapé, il réclame sa facture. Quand il achète une voiture il réclame sa facture et la carte grise. Quand il achète un chien, il ne réclame rien, pourtant il s'agit d'un être vivant. http://www.best.of.ghostdance.jed.st/docs_officiels.htm
il serait bien de faire un paragraphe dans la rubrique "achat chien" d'un article de loi concernant le retour, par un acheteur, d'un chien qu'il est venu chercher chez l'eleveur et payé ,signé l'attestation de vente, de rapporter le chien et demander le remboursement .
le probleme c'est que rare sont les personnes qui sachent que lorsqu'ils acquierent un chiot, ils doivent avoir un certificat de vente ou de don. il est encore plus rare de voir les personnes ne sachant pas ce qu'est un "pittbull". même si la loi qui le décrit est completement nul sur les chiens de 1ere cat vis à vis de ceux de 2eme (mais c'est une autre sujet). trop de personnes donnent ou vendent des chiens X sans carte d'identification et sans certificat.....